Mémoire sur la vie familiale à l’épreuve du surendettement : les impacts de ce phénomène sur les relations sociales entre les membres (DECESF et DEASS)
Si vous réalisez un mémoire sur la thématique du surendettement, je vous invite à poursuivre la lecture de cet article.
En effet, je tenais à vous proposer sur mon site un exemple tiré d’un mémoire d’une étudiante CESF que j’ai accompagnée dans l’élaboration de son mémoire et qui a validé son épreuve haut la main.
Bon courage !
Articles susceptibles de vous intéresser :
Une ISC avec proposition d’actions
5 conseils pour réussir son oral
Comment présenter sa soutenance mémoire ?
Vous rencontrez des difficultés dans la rédaction de vos écrits ou de vos soutenances orales ?

Vous n’avez pas le soutien nécessaire de la part de vos formateurs ?

Vous faites face à des obstacles pour trouver du temps pour élaborer vos dossiers car vous avez une vie de famille ? un travail prenant en parallèle ?
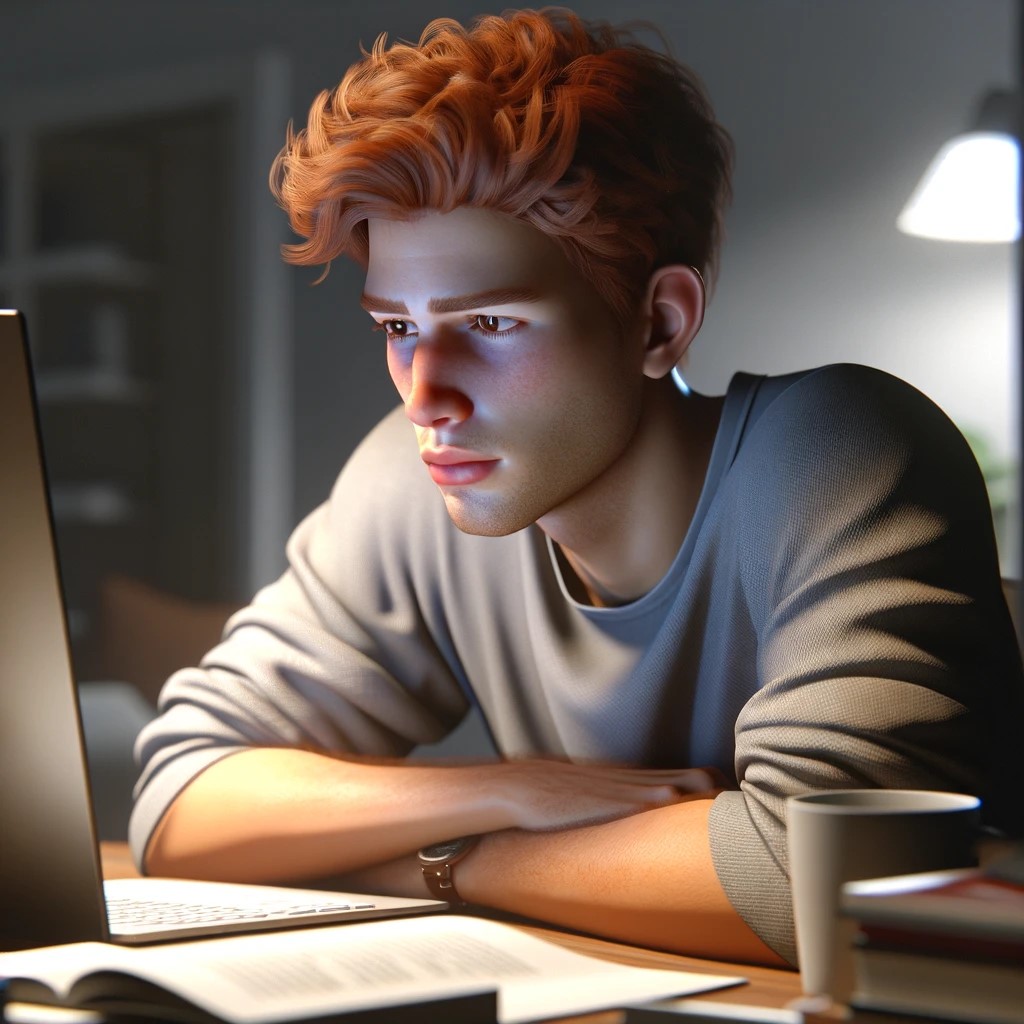
Vous êtes à quelques semaines du rendu final et vous vous dites que ce que vous avez rédigé n’est pas cohérent ?
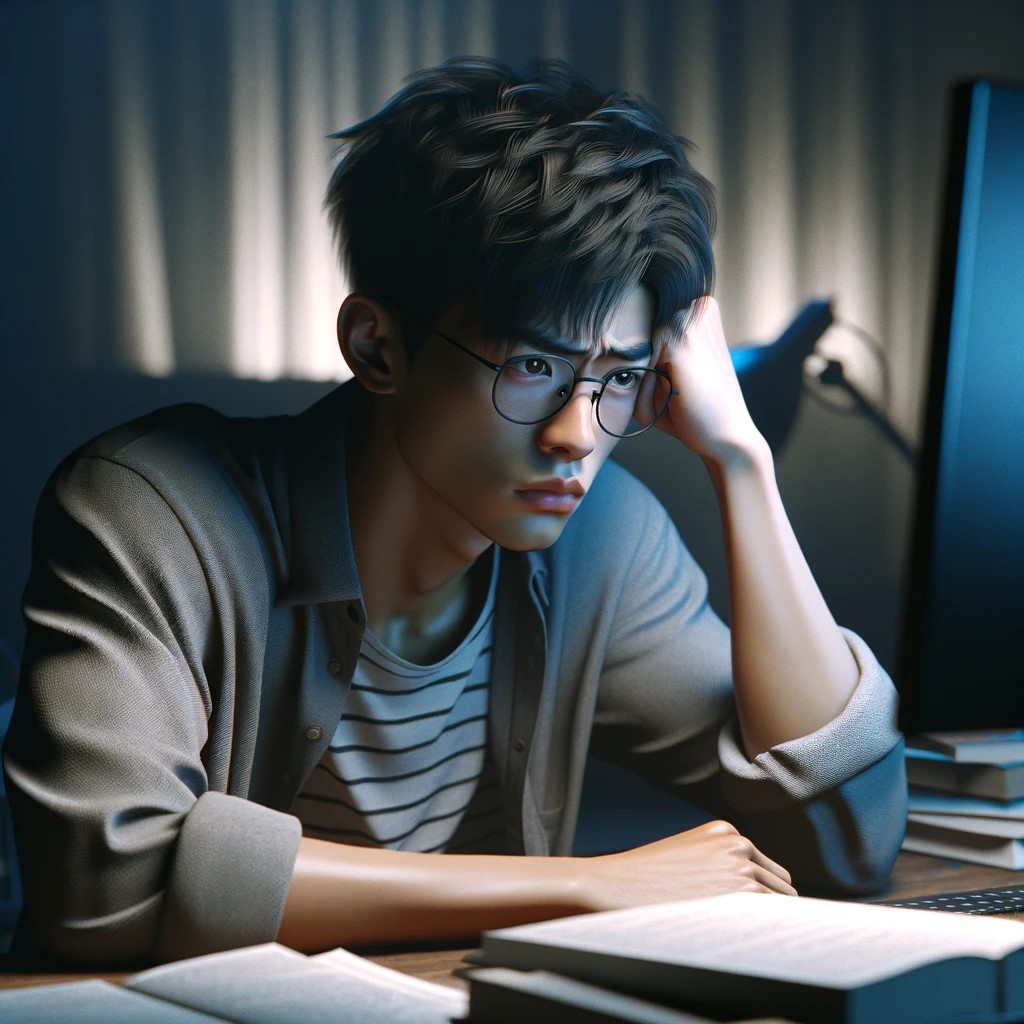
Vos formateurs ou le jury blanc vous demande sans cesse de modifier vos écrits et vous ne savez plus comment avancer ?

Si vous ne validez pas votre diplôme, vous allez devoir faire face à d’importants enjeux familiaux ou financiers ?
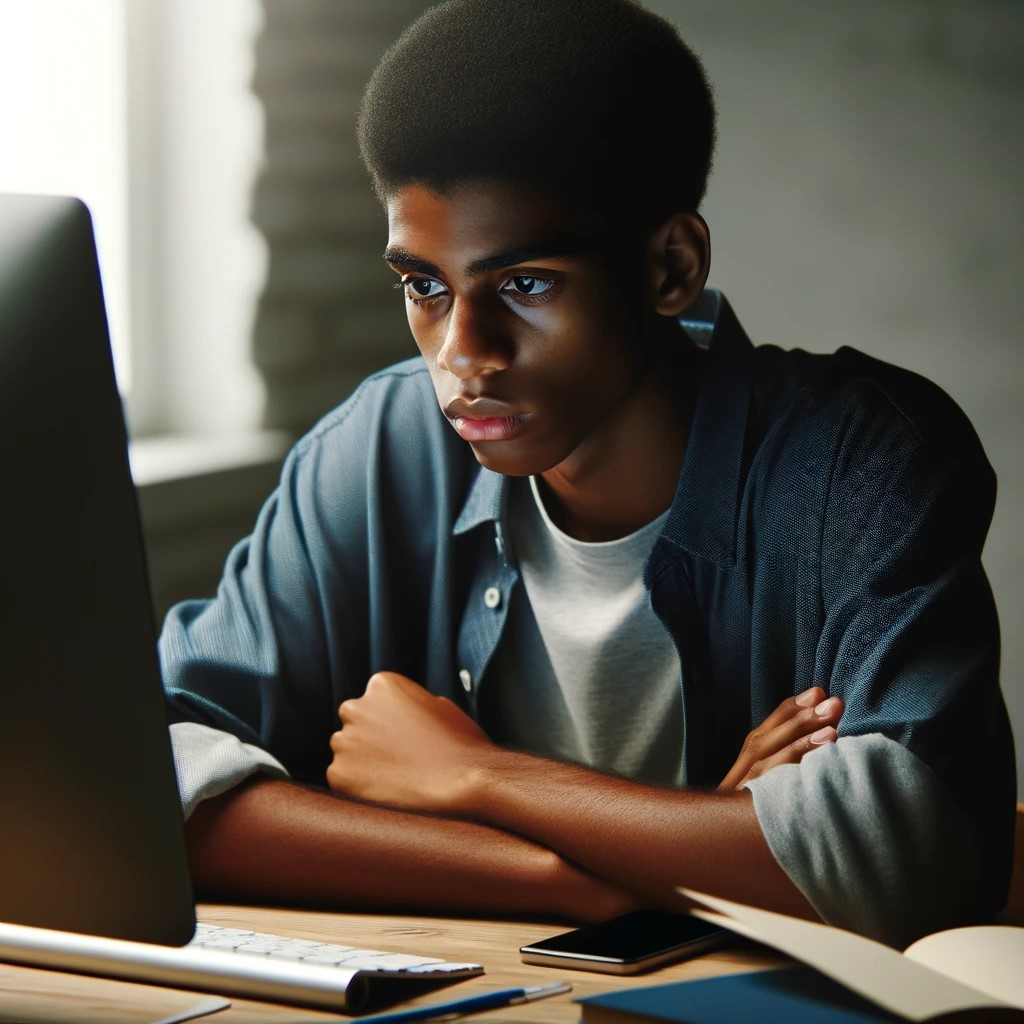
Si vous vous sentez concerné(e) par ces différents obstacles, je vous invite à me contacter.
Je suis Sébastien, expert du secteur médicosocial et mentor des étudiants du social, de l’éducatif, du paramédical, de l’encadrement, licence/master universitaire et des candidats à la VAE (livret 2).
N’attendez plus le dernier moment pour avancer dans vos dossiers et subir le stress de la page blanche ou de la procrastination.
En effet, tout comme vous j’ai été confronté à des études éprouvantes (formation d’assistant social, puis CAFERUIS et master en sociologie des organisations option management et ressources humaines).
J’ai dû travailler en parallèle de ma scolarité mais aussi suivre mes formations alors que j’avais des enfants en bas âge.
Ce sont les freins et le manque que j’ai vécus qui m’ont incité à proposer mes services d’accompagnement.
Ainsi, je vous propose d’en savoir davantage sur mon parcours, mes prestations, la Foire Aux Questions (FAQ) et mes tarifs en cliquant sur les liens suivants (également disponible dans le menu) :
Mon (fabuleux) programme de correction
Introduction : mémoire sur le surendettement et son impact sur la dynamique familiale
Selon les derniers chiffres de l’INSEE , 14,3% de la population française est pauvre, soit environ 8,6 millions de personnes qui subsistent sous le seuil de pauvreté fixé à 987 euros par mois. Si les situations d’extrême pauvreté ont diminué de moitié depuis les années 1970, le visage, en revanche de la pauvreté a lui changé et muté puisqu’à présent il est susceptible de concerner toutes les couches sociales de la population. La question sociale de la pauvreté a véritablement émergé au cours des années 80. En effet, au cours de cette période, la figure du pauvre auparavant marginale et ayant vocation à être éradiquée grâce au progrès social s’est finalement installée en France. Cette situation s’explique en partie par les évolutions marquantes du marché du travail qui s’est davantage flexibilisé et précarisé depuis la survenue de la crise économique datant de 1973. En parallèle, la société assiste à l’apparition d’un phénomène qualifiée d’exclusion (R. Lenoir, 1978) dont l’analyse a par la suite été affinée par plusieurs auteurs (R. Castel, 1991 ; S. Paugam, 1991) qui mettent en évidence les risques de désaffiliation ou de disqualification sociale pour les populations.
Face à la montée de la précarité (Wresinski, 1987) de multiples politiques d’assistance puis d’insertion ont émergé en France afin de pallier les situations de pauvreté des ménages dans un contexte de crise économique. Ainsi, face à la réduction monétaire, de la montée du chômage et de la volonté de s’inscrire dans une société de consommation de masse, un taux important de la population a eu recours aux crédits bancaires. Ces derniers se sont en effet fortement généralisés en raison notamment du désencadrement du crédit, de la chute brutale de l’inflation et de la multiplication des impayés qui ont incité les ménages à entrer dans une spirale du surendettement. De ce fait, les pouvoirs publics ont fortement pris en considération ce phénomène grandissant en proposant des lois successives visant à enrayer cette situation. La première disposition législative marquante a été votée par la France en 1989 à travers la loi Neirtz afin de se doter d’une véritable procédure de traitement du surendettement des particuliers. La France est ainsi le deuxième pays d’Europe après le Danemark à mettre en place des mesures visant à soutenir les personnes de bonne foi lorsque leur situation s’avère en partie ou totalement compromise afin d’éviter le risque d’exclusion. Cette modalité d’intervention orientée auprès des personnes leur permet, après une évaluation par une commission qui siège à la Banque de France de proposer un gel temporaire des remboursements, un plan conventionnel fixant un remboursement à hauteur de la capacité budgétaire et enfin en cas de situation irrémédiablement compromise une procédure d’effacement des dettes peut être mise en œuvre. En parallèle, plusieurs lois se sont succédées jusque la dernière en date du 17 mars 2014 (dite loi Hamon) et entrée en vigueur au 1 juillet 2016 afin de renverser ces situations financières complexes.
Pourtant, de plus en plus de ménages sont surendettés puisque 223 012 dossiers ont été déposés à la Banque de France en 2013 contre 220 836 en 2012. Parmi ces ménages 43 % ont au moins un enfant à charge . Ainsi, les personnes surendettées doivent faire face à des bouleversements au niveau de leur mode de consommation ce qui constitue une remise en cause particulièrement violente de leurs habitudes . En effet, du fait des restrictions budgétaires engendrées par la situation de surendettement les familles sont amenées à réaliser des « coupes sombres dans la plupart des postes budgétaires avec des conséquences très lourdes sur le plan humain » . De ce fait, les parents doivent prioriser les besoins de première nécessité au détriment de certaines activités culturelles ou de loisirs. Les enfants lorsqu’ils sont concernés par ces modifications de leur quotidien se situent dans une zone d’incompréhension qui est susceptible d’impacter les rapports intrafamiliaux.
2 Les motivations ayant suscité l’intérêt du sujet
Pour ma part, les premières interrogations vis-à-vis du public en situation de surendettement et de l’impact de cet état sur la vie familiale a émergé au cours de mon stage de première année de BTS en Economie Sociale et Familiale (ESF) que j’ai réalisé dans un Centre Communal d’Action sociale. Il s’agit d’un service social rattaché à la municipalité qui proposait aux habitants de la commune des aides sociales et alimentaires aux personnes en difficulté.
Au cours de cette expérience, j’ai pu observer que l’institution accueillait un grand nombre de personnes qui sollicitaient la CESF en poste afin d’être soutenues dans l’élaboration de leur dossier de surendettement. Ainsi, ces rencontres dont la porte d’entrée étaient la résultante d’une demande d’aide et de soutien au niveau de cette démarche administrative était souvent l’opportunité d’échanger autour du vécu de ces familles. Celles-ci parvenaient en effet à livrer des éléments relevant de leur vie quotidienne à travers un retour sur les causes de leur situation de surendettement, la façon dont le budget était géré et notamment des évènements souvent imprévisibles qu’elles ont vécus.
Au cours de ces entretiens, je portais un intérêt fort aux dires des personnes qui semblaient être dans une détresse morale voire psychologique qui n’était pas uniquement liée à la déstabilisation budgétaire qu’elles vivaient. En effet, ces parents verbalisaient de façon récurrente un profond sentiment d’échec surtout en raison de leur incapacité à répondre aux demandes des enfants. Ils expliquaient à ce titre qu’ils regrettaient que ces derniers soient impactés au quotidien alors qu’ils n’étaient pas responsables de cette situation.
En parallèle, ces mêmes parents évoquaient ressentir un sentiment de honte voire d’humiliation face à leur nouveau statut qui ne leur permet plus, selon eux, d’accéder à une consommation et à des services qu’ils avaient l’habitude de solliciter auparavant. A ce titre, parmi eux, un certain nombre avait fait part à ma référente CESF et moi-même qu’ils ne parvenaient plus à s’inscrire dans des activités sociales et préféraient s’isoler afin de ne pas être décrédibilisés par rapport à leur difficulté financière.
Enfin, d’autres couples ont également livré des tensions au sein de la cellule familiale du fait de la modification de leurs habitudes de vie. En effet, j’ai pu observer à de nombreuses reprises des partenaires qui se rejetaient la faute dans cette situation de surendettement ou d’autres qui expliquaient que leurs enfants adoptaient des attitudes de retrait ou à l’inverse de sur-sollicitation depuis que les difficultés ont démarré.
Me concernant, j’ai souhaité explorer le phénomène du surendettement lorsque celui-ci s’installe au sein d’une famille en analysant notamment les impacts de cette situation sur les relations sociales entre ses membres. En effet, à l’issue de mes premières recherches théoriques posées dans les constats de départ que j’ai confrontées à l’observation active faite au cours de mes stages j’ai saisi que ces familles sont soumises à de fortes pressions qui, je le suppose, déstabilisent aussi bien les parents se sentant coupables que les enfants témoins de cette dégradation de la qualité de vie.
Par ailleurs, j’ai conscience, en tant que future CESF, que je serai amenée à intervenir auprès de familles en situation de surendettement. Ainsi, j’évalue qu’au-delà d’un traitement uniquement orienté vers un soutien dans la constitution du dossier à transmettre à la Banque de France il convient de pouvoir être en capacité de soutenir ces personnes sur le plan moral. En effet, selon moi, le travailleur social peut-être en capacité de développer des compétences dans le soutien et le repérage des situations à risques pour une famille afin de pouvoir apporter des éléments de réponse aux besoins identifiés. En ce sens, je souhaite intégrer des savoirs qui me permettront d’évaluer la vulnérabilité des personnes afin de proposer un projet d’intervention qui vise à aller plus loin que le seul traitement de la déstabilisation budgétaire.
C’est pourquoi à l’issue de cette réflexion engagée j’ai fait le choix de poser la question de départ suivante :
Dans quelle mesure la survenue de la situation de surendettement influence-t-elle les relations sociales entre tous les membres de la cellule familiale ?
Afin d’explorer cette interrogation ce mémoire s’articule en deux parties. La première, intitulée « La phase exploratoire » croise les données théoriques aux éléments recueillies lors de l’investigation de terrain menée. Ainsi, cette phase repose sur trois chapitres.
Le premier met en lumière le phénomène du surendettement à travers un retour historique et juridique permettant de saisir le contexte d’émergence de ce phénomène tout en relevant comment il se met en place de façon concrète à travers les modalités d’accès à ce dispositif.
Le deuxième chapitre, quant à lui, expose les impacts de la situation de surendettement niveau de l’insertion sociale des personnes concernées. Nous verrons ainsi que ces dernières peuvent être mises à mal aussi bien dans leurs relations sociales avec leur environnement qu’au niveau de leur identité.
Le troisième chapitre, met en évidence les rapports intrafamiliaux qui s’opèrent entre tous les membres concernés par la survenue du surendettement. Nous constaterons ainsi que chacun d’entre-deux adoptent des stratégies de défense différentes permettant de pallier les difficultés constatées au quotidien.
Puis, la deuxième partie de ce mémoire intitulée « La phase de problématisation » correspond à la mise en lumière d’une problématique majeure ayant émergé de cette recherche ainsi que la proposition d’une question de recherche accompagnée de son hypothèse et d’outils de vérification de celle-ci.
Enfin, je conclue ce mémoire avec les apports de cette démarche d’enquête sur ma pratique et mon positionnement professionnel.

Laisser un commentaire